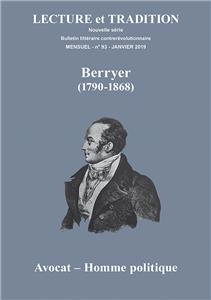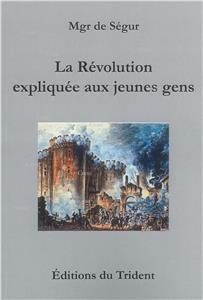Notre plus grand diviseur commun
Notre plus grand diviseur commun
Au lieu de nous lamenter sur le déclin des institutions depuis 50 ans, nous devrions comprendre que nous subissons, depuis le début les institutions même du déclin.
C’est bien dans leur cadre qu’ont été adoptées, en effet, les orientions que nous déplorons. Cela vaut pour le fonctionnement de l’État, mais aussi pour l’évolution de l’éducation nationale, pour les consanguinités économiques ou pour la toute-puissance de la haute administration. Toutes ces caractéristiques de la Cinquième République ont engendré la médiocrité générale. On ne saurait donc critiquer les conséquences, sans vouloir interroger les causes.
Les derniers développements de la crise du coronavirus appellent, à eux seuls, beaucoup de remarques. À cet égard, le confinement imposé, pour des raisons parfaitement compréhensibles précisons-le, aura au moins le mérite de libérer et de stimuler notre réflexion.
Au risque de déplaire, celle-ci ne saurait faire l’économie du bilan négatif de l’héritage gaullien, si souvent vanté par ceux-là même, à droite, qui devraient s’en défier.
On entend souvent les politiciens parler, à contresens, d’un plus petit dénominateur commun : expression fausse et absurde qui ne saurait aboutir qu’à l’unité, ou à la nullité. En arithmétique, on ne recherche que le plus petit multiple ou le plus grand diviseur. Et par expérience, en France le PGCD, au cours du XXe siècle, s’appela Charles De Gaulle. Il ne faudrait même plus en parler.
Hélas, en cette année 2020, va savoir pourquoi, on nous somme de célébrer le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de son intervention à la BBC, et le 50e de sa disparition. Et comme nous subissons, aujourd’hui encore, les personnages de plus en plus falots qui lui ont succédé, nous finissons par mesurer son hypothétique grandeur à l’aune de leur petitesse.
Et l’observation de ces hommes incertains et cependant si péremptoires, quand ils communiquent leurs consignes par les lucarnes télévisuelles, devrait nous conduire à réhabiliter les cultures politiques incorrectes.
C’est donc aujourd’hui un regard objectif nouveau, tiré de l’expérience, qui prend le relais des écoles de pensée, certes diverses mais convergentes, de la vraie droite française. On reviendra, dès lors, d’une manière ou d’une autre aussi bien à celle du nationalisme intégral d’un Charles Maurras, aux jalons de route vers un ordre social chrétien d’un La Tour du Pin ou au travail historique critique d’un Beau de Loménie, lui-même continuateur de la sociologie chrétienne.
Du mépris du peuple français au présidentialisme
C’est à tort en effet que l’on se réfère à De Gaulle comme s’il s’agissait d’un grand constructeur. Son sens personnel démesuré, dénoncé par Bastien-Thiry dans son héroïque et tragique déclaration en février 1963, le situait au contraire dans le syndicat des destructeurs [1]. N’ayant retenu de Nietzsche que le mépris des hommes, ce faux chrétien réservait son dédain, non sans méthode, à ses propres compatriotes. Il ne pouvait ainsi que les desservir.
Beaucoup de Français croient ou feignent de penser que le général De Gaulle nous aurait légué des institutions solides et stables.
Une telle illusion revient à perdre de vue que la constitution de 1958 fut révisée 24 fois en 50 ans, la dernière vague remontant à l’ère Sarkozy en 2008. La réforme constitutionnelle de 2008 modifia elle-même, à elle seule, près de 50 articles. De plus, outre les 24 projets ou propositions effectivement adoptés, 14 autres n’ont pas abouti.
Et au bout du compte, ce sont bien les héritiers du gaullisme qui auront charcuté le plus méthodiquement le texte de leur idole.
La plus dramatique confrontation transforma en 1962 l’article 7, aboutissant, depuis cette date, à l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct. Le résultat fut de transformer les deux scrutins suivants, celui de 1965 puis celui de 1969, en autant de référendums pour ou contre la survie de l’ère gaullienne. À partir de 1974, avec les élus successifs, Mitterrand succédant à Giscard en 1981, Chirac en 1995, Sarkozy en 2007, Hollande en 2012, Macron en 2017, chaque fois de pis en pis, on en vint à laisser se déliter l’État, et l’idée même que la nation se représentait de son destin. L’instauration du quinquennat en 2000 ne manqua pas non plus de faire évoluer le régime toujours dans le sens de la dégradation et de la primauté, toujours accrue du rôle du président, accentuée comme on n’a cessé de le voir par la décision, sous le gouvernement Jospin et la deuxième mandature Chirac de placer les élections législatives après le scrutin présidentiel.
Rappelons à ce sujet que l’une des forces principales des institutions américaines, que l’on se plaît tant à faire semblant d’imiter à Paris, repose sur un vote à date fixe, tous les deux ans définie en 1792, à peine modifiée en 1845, le même jour pour l’ensemble des institutions fédérales, ce qui contribue puissamment à l’équilibre de leurs relations. Or, l’énoncé de ce concept de séparation des pouvoirs, que la vulgate maçonnique voudrait faire remonter au XVIIIe siècle, fait tellement partie de l’ordre naturel des sociétés qu’on le trouve déjà en germe, plus de deux mille ans avant L’Esprit des lois de Montesquieu, dans la Politique d’Aristote.
Mais il appartenait à la destinée comme à la logique du Sens personnel démesuré, de conduire sa version de la république à un pouvoir présidentiel non moins démesuré.
L’esprit faux du discours de Bayeux
La fonction centrale du régime politique que nous appelons Cinquième République, reste depuis lors, celle des présidents tout-puissants élus depuis la réforme de 1962.
Mais ce n’est pas en 1958, par la plume de Michel Debré, lui-même assisté de quelques juristes oubliés réunis pendant l’été, qu’est né le texte de la loi fondamentale, adoptée cette année-là, par référendum. Les principes constitutionnels gaullistes remontaient au discours de Bayeux de 1946, ébauche fondatrice de la doctrine de son parti.
L’année 1946, De Gaulle, précédemment chef du gouvernement provisoire ayant démissionné le 20 janvier, c’est aussi celle du plan de sécurité sociale d’Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, mais aussi du statut du fermage sous l’inspiration de Waldeck Rochet, alors responsable des questions agricoles à la direction du PCF, de la nationalisation des assurances, en vertu d’un rapport de Jacques Duclos, c’est le statut de la fonction publique institué par Maurice Thorez. C’est la grande époque du PCF. Celui-ci avait dominé la première constituante. Se proclamant le premier parti de France, l’appareil stalinien était parvenu à faire outrepasser par l’assemblée le pouvoir d’élaborer la loi fondamentale pour lequel elle avait été élue en 1945. Entre le vote de leur projet constitutionnel, le 16 avril, et le référendum du 5 mai, qui devait la ratifier, ses députés avaient fait entériner un certain nombre de ses prétendues conquêtes sociales.
Or, à une courte mais nette majorité de 53 %, le corps des électeurs rejeta le texte le 5 mai. Ceci allait conduire, le 2 juin, à l’élection d’une nouvelle constituante qui adopta un autre projet beaucoup moins influencé par les communistes et qui fut adopté.
Dans ce contexte, De Gaulle a pu paraître, alors, comme une sorte de rempart contre le communisme, sur la base d’un contresens absolu. Celui-ci, et on semble l’avoir complètement oublié, fera surnommer son RPF, fondé en 1947, comme le parti américain. Nombre de ses cadres allaient s’engager dans la guerre de Corée, alors que l’armée française combattait en Indochine. Cette même lutte politico-militaire allait se poursuivre et se prolonger en Afrique du Nord contre un ennemi renforcé par l’alliance, scellée par les militants communistes du monde entier et les islamistes algériens, lors du congrès FLN clandestin de la Soummam, en août 1956.
Or, la Quatrième République n’est pas seulement morte de la crise algérienne : elle a fondamentalement payé le prix de l’élection bancale de René Coty devenu président en décembre 1953, après treize tours de scrutin. Le régime parlementaire était largement discrédité. On lui imputait toutes les difficultés, tous les échecs, toutes les humiliations du pays, tributaire de l’aide financière des États-Unis, incapable de mettre de l’ordre dans son budget et dans sa monnaie.
Le présidentialisme remontait bien au-delà du général lui-même. Le bonapartisme, le boulangisme, les ligues, et des hommes politiques comme Tardieu en avaient flatté la perspective et le discours antiparlementaire. En vain, dès le XIXe siècle, un auteur contre-révolutionnaire comme Mgr Louis-Gaston de Ségur, après Chateaubriand, après Berryer [2], avait mis en garde contre le césarisme plébiscitaire qui en résultait.
Jean-Gilles MALLIARAKIS
Extrait du n° 756 (avril 2020) – Pour lire la suite de cet article, commandez ce numéro ou abonnez-vous !
[1] – Déclaration du 2 février 1963 (Éd. Cercle Bastien-Thiry, 1998).
[2] – NDLR : Voir l’étude qui a été consacrée à ce dernier par Michel Pierchon dans le n° 93 (nouvelle série, janvier 2019) de notre revue sœur Lecture et Tradition.