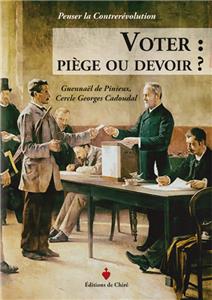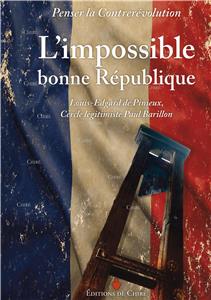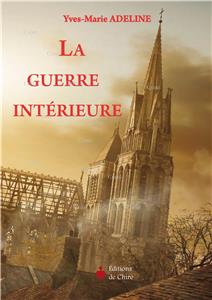Le cercle, l’angle et le miroir. Trois théories sur l’élection
Nous proposons ici d’exposer trois théories en les intégrant à l’évolution du paysage politique français depuis 1981, entre la période giscardienne et l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République.
La théorie du cercle
Présentons-nous l’électorat comme un cercle fermé ayant une valeur constante de 100 %. Autrement dit, quel que puisse être le diamètre de ce cercle, il conserve toujours la même valeur de 100 %. On peut comparer avec l’univers qui est à la fois fini et en expansion : il demeure à 100 % même quand il s’agrandit. Il le resterait toujours s’il se rétrécissait.
De fait, aucun pourcentage ne peut être ni soustrait ni ajouté au cercle électoral.
Dans la pratique, lorsqu’un candidat se présente aux élections, il n’ajoute aucun pourcentage au cercle, mais il en obtient à l’intérieur de cet espace. En admettant qu’il apporte des voix nouvelles, il pourra augmenter le diamètre du cercle, mais pas son pourcentage, qui reste constant à 100. Ainsi, sa participation à l’élection – son entrée dans le cercle – diminue nécessairement le pourcentage d’au moins un candidat rival [1].
Mais généralement, lorsqu’il se présente pour la première fois, un candidat n’apporte pas de voix nouvelles : il détourne une part des voix pré-existantes à son profit. Globalement, on peut dire qu’il n’a pas créé les voix qui se sont portées sur lui, mais les a prises à d’autres.
C’est d’ailleurs ce qui explique la sourde violence des consultations électorales, car tout candidat ne peut que regarder ses rivaux, au premier rang desquels ceux qui lui sont politiquement les plus proches, comme des concurrents susceptibles de diminuer son pourcentage de voix.
Observons l’évolution du paysage politique français depuis l’époque de Valéry Giscard d’Estaing jusqu’à nos jours. Dans la deuxième moitié de son septennat, quand le président Giscard d’Estaing crée son propre parti – l’UDF [2] – pour résister à l’offensive politique de son ancien Premier ministre Jacques Chirac [3], le paysage politique, regardé comme un cercle, se partage en quatre parts principales : de la gauche vers la droite, le parti communiste conduit par Georges Marchais, le parti socialiste conduit par Mitterrand, l’UDF, donc, et le RPR de Chirac.
Aux législatives de 1978, le parti le plus important en nombre de sièges est le RPR (154 députés) qui outre, les gaullistes, recueille le vote de la partie radicale [4] de l’électorat de droite, laquelle reproche à Giscard de pratiquer un centrisme et un libéralisme moral déroulant le tapis rouge devant les idées de gauche. Le deuxième parti est celui du président (123), puis vient le PS (113), enfin le PC (86) qui passe derrière le PS [5]. Ce déclin des communistes, longtemps premier parti de France après 1945, n’est pas dû aux seules manœuvres de Mitterrand consistant à les embrasser pour mieux les étouffer, mais encore à une évolution générale du contexte politique – montée en petite bourgeoisie des classes moyennes, amélioration des conditions de travail, déclin démographique de la classe ouvrière et son remplacement progressif par la main-d’œuvre immigrée apolitique, diminution de l’influence du PC au profit des gauchistes de Mai 68, montée des trotskistes contre les staliniens, essoufflement de l’URSS, etc. – et aussi, probablement, à l’image décrédibilisante que renvoie sa figure de proue, Georges Marchais, bretteur médiatique peu à peu tombé dans le piège d’un rôle de comique.
De fait, la victoire de François Mitterrand le 10 mai 1981, en dépit de l’alliance de deuxième tour, puis de gouvernement, avec le PC, rebat les cartes non pas tant à gauche, mais à droite, où l’élection de Mitterrand est comprise moins comme une victoire de la gauche que comme le désaveu de la politique giscardienne par la droite radicale – sans parler des consignes données secrètement au sein du RPR pour faire battre Giscard en votant Mitterrand. Le président sorti ne peut revenir indemne d’un événement que la droite a vécu comme un cataclysme politique – elle se voyait depuis De Gaulle comme le seul bénéficiaire possible et locataire légitime de la Ve République dont la constitution est monarchique. Ainsi, le nouveau chef naturel de la droite devient Jacques Chirac, jusqu’alors considéré, à gauche comme à droite, comme un candidat de droite radicale ou assimilé comme tel, n’était sa revendication de l’héritage gaullien qui le sépare définitivement des antigaullistes de droite (partisans de Vichy, ou de l’Algérie française, ou des deux ; anticommunistes n’ayant pas pardonné au Général d’avoir accueilli des communistes en son gouvernement à la Libération, etc.) : en dépit du maintien de la division entre UDF et RPR, c’est Chirac qui s’impose, l’UDF ne parvenant pas à se donner un nouveau chef, d’autant que Giscard persiste à s’y maintenir à la première place en dépit du discrédit qui le frappe, non plus seulement dans la droite radicale, mais dans son propre camp où on lui reproche d’avoir été vaincu.
La théorie des angles
A partir de ce moment-là, dans le cercle fermé de l’espace électoral, s’ouvre un angle pour Chirac : à sa gauche, c’est-à-dire à l’UDF, un espace est à remplir, que ne peut plus occuper intégralement Giscard ou ses héritiers.
Pour le comprendre, il nous faut exposer un deuxième principe, celui des angles. Dans ce cercle électoral fermé, les pourcentages réalisés par les différentes composantes politiques créent des portions plus ou moins grandes, des angles plus ou moins ouverts. Or, selon les circonstances, ces angles s’ouvrent ou se ferment devant la politique que propose un candidat. On peut même dire que le plus souvent, la réussite d’un camp ne fait que découler des erreurs du camp opposé. C’est d’ailleurs ce que déclare, en juillet 1981, Pierre Juillet, ancien conseiller de Chirac [6] : « Ce qui perd toujours le vainqueur, c’est de croire en sa supériorité, alors qu’il ne devrait considérer que la faiblesse de son adversaire » [7].
La droite
Une illustration caractéristique de cette loi des angles se reconnaît dans une période, très courte mais la plus intense, de la carrière politique nationale de Philippe de Villiers, entre 1992 et 1995. A l’occasion du référendum de 1992 où ce quasi-inconnu – que ses idées politiques placent entre Le Pen à sa droite, et à sa gauche l’aile droite de la droite parlementaire, donc dans un tout petit espace – a la chance de pouvoir faire équipe avec Charles Pasqua et Philippe Seguin pour constituer une troïka représentant la droite parlementaire anti-maastrichienne [8], Villiers se fait reconnaître comme un chef auprès d’un électorat très vaste : en effet, le Traité a été désapprouvé par 49 % des électeurs, et l’on observe que dans la droite de gouvernement (c’est-à-dire la droite sans le FN), ceux du RPR ont été les plus réticents, tandis que la plus grande partie de l’UDF s’est prononcée au contraire en sa faveur. La campagne a divisé cette droite, tandis qu’à gauche, seul ou presque, le PC a pris position contre le Traité [9].
Notons toutefois que cette division de la droite ne l’empêche pas de gagner très largement les législatives de 1993, profitant de l’embourbement du pouvoir mitterrandien dans des scandales politiques de diverses natures.
A la fin de cette même année, dans la perspective des élections européennes de juin 1994, le RPR et l’UDF s’entendent pour la formation d’une liste commune à coloration maastrichienne, et l’on prévoit qu’elle sera conduite par Jean-François Deniau, un UDF dont la popularité en tant qu’homme (auteur, navigateur…) excède largement les frontières des partis politiques.
Villiers, souhaitant rentabiliser sa notoriété récemment acquise, et espérant rallier les anti-maastrichiens des deux partis, présente sa propre liste, qui pourtant ne décolle pas dans les sondages, à cause de l’image positive de Deniau… jusqu’à ce que les états-majors de l’UDF et du RPR décident en fin de compte de placer en tête de leur liste un centriste radical, Dominique Baudis, qui est spontanément rejeté par l’aile droite du RPR. Alors s’ouvre pour Villiers un angle à sa gauche, et ainsi réalise-t-il un score de 12 %.
Convaincu qu’il a réussi à se forger un électorat fidèle [10], Villiers se présente à la présidentielle de 1995 : mais dans ce nouveau contexte, il doit se mesurer à deux candidats de la droite gouvernementale : Chirac qui rassemble un RPR dont la majorité des militants restent disciplinés, et Balladur, qui bien qu’issu du RPR porte surtout les espoirs d’une UDF devenue incapable de se trouver un chef et pour cela condamnée au déclin ; tandis que Le Pen peut espérer garder son niveau d’étiage alors fixé – depuis 1984 – à 10 % minimum. L’angle se ferme donc pour Villiers qui ne recueille que 4,75 % – d’autant qu’en définitive, Le Pen a recueilli 15 %. Jamais ne se rouvrira pour Villiers un angle, dont l’ouverture dépend des circonstances : les exemples sont variés, pensons aussi à François Hollande, désigné par le PS à la candidature présidentielle de 2012 grâce au soudain naufrage judiciaire de Dominique Strauss-Kahn, qui lui ouvre un angle inattendu.
Mais revenons à l’après-10 mai 1981, quand le centre-droit privé de chef incontestable est à conquérir : Chirac, reprenant à son compte l’idée giscardienne disposant qu’une élection se gagne au centre – idée que l’on croit alors figée dans la pratique, mais qui est en réalité tantôt pertinente tantôt illusoire selon les circonstances, comme nous le verrons – privilégie cette direction, au prix d’un relâchement de ses liens avec son électorat radical. En conséquence, cette fraction de l’électorat se sent abandonnée. C’est ainsi qu’émerge le FN, dont l’ascension est attribuée à trois facteurs : la disponibilité d’un espace politique déserté par Chirac, le savoir-faire de Le Pen qui se révèle capable d’investir cet espace – on trouve l’addition de ces deux premiers facteurs aux européennes de 1984 où la liste FN perce à 11 % – et la manœuvre mitterrandienne consistant à adopter le scrutin proportionnel, pratiqué aux européennes et qui a donc permis la percée lepéniste ; et ainsi diviser une droite en passe d’être monopolisée par Chirac, en instituant la proportionnelle pour les législatives de 1984 ; où en effet le FN renouvelle quasiment son score – 9,5 % – et s’inscrit durablement dans le paysage politique français.
La gauche
A gauche, le paysage se transforme également. S’il apparaît que la gauche a gagné ses combats contre la droite en matière sociétale, depuis la loi du 17 janvier 1975 [11] jusqu’à celle du 17 mai 2013 autorisant le mariage homosexuel, jusqu’à convaincre peu à peu la droite du bien-fondé de ses différentes initiatives, en revanche on assiste à un mouvement inverse en matière de gouvernement économique : l’échec des économies administrées fait adhérer la plus grande partie de la gauche, représentée par le PS, aux principes de l’économie de marché.
Sous la période mitterrandienne, deux angles s’ouvrent, l’un à de nouvelles formulations communistes, l’autre à l’écologisme.
Tout d’abord, on assiste au recul continu du PCF, victime de l’essoufflement idéologique et économique de l’URSS, ce qui ouvre un espace à d’autres tendances communistes, et aussi au courant écologiste. Mais cette ouverture est due également à l’évolution idéologique du PS, qui ne profite pas au PCF mais à des tendances communistes jusqu’alors marginales, d’obédience trotskiste : essentiellement Lutte Ouvrière et la Ligue Communiste Révolutionnaire, qui bien que rivales ont parfois fait liste commune. Le tournant de la rigueur opéré par Mitterrand en 1983, son adoption d’une logique économique libérale, que Lionel Jospin continuera en 1995, aliènent au PS la gauche radicale qui réalise des scores électoraux jamais atteints : l’alliance LO-LCR dépasse les 5 % aux européennes de 1999 quand la liste du PCF n’atteint pas 7 % ; Arlette Laguiller (LO) renouvelle l’exploit en 2002 en frôlant les 6 %, quand Robert Hue, le candidat du PCF, dépasse péniblement les 3 %.
L’écologie
La percée des écologistes est un phénomène plus profond. On hésite parfois sur la connotation politique de cette tendance, tant il est vrai que le respect de la nature peut ressortir d’une attitude de droite attachée à la conservation, au fonctionnement économique traditionnel des collectivités, et méfiante à l’égard du progrès. Il n’empêche que c’est à gauche qu’il s’est inscrit dès lors qu’il s’est cherché une forme politique, ne serait-ce que parce que la société industrielle pollueuse, contre laquelle se dresse l’écologisme, fait la part belle aux concentrations de capital contre lesquelles c’est le plus souvent la gauche qui s’est opposée, à travers des penseurs comme Proudhon ou Marx. En outre, dans sa formulation la plus radicale, l’écologisme prône un biocentrisme qui remet en cause l’anthropocentrisme exploiteur des richesses naturelles, ce qui induit une discipline de vie collective cherchant à rompre avec l’ordre traditionnel. D’ailleurs, en dépit de quelques meneurs comme Antoine Waechter qui a défendu l’idée d’un écologisme indépendant, c’est-à-dire susceptible de s’allier autant à droite qu’à gauche, l’écologisme a aspiré un grand nombre d’électeurs de gauche et se présente comme un mouvement de gauche entendant associer la défense de l’environnement aux revendications sociétales et économiques.
Du point de vue de la pensée économique, il semble évident à cette tendance que la recherche d’un accroissement sans fin de la richesse, à laquelle se livrent nos sociétés tant libérales que socialistes (pensons aux pollutions soviétiques et chinoises) nuit à l’harmonie du monde et à celle entre les hommes (d’où la nécessité de bien définir le développement durable, orienté vers la consommation responsable et même l’équité entre les hommes – quitte à promouvoir la décroissance – plutôt que vers un développement brut). Ces questions sont prises en charge majoritairement à gauche, de sorte que les écologistes ont attiré vers eux un pourcentage électoral, toutefois très variable, et même instable compte tenu de la tendance de ce parti au morcellement et aux divisions internes, dues à l’intransigeance inhérente à toutes les pensées se donnant pour objet de renverser l’ordre actuel des choses.
A l’époque giscardienne, le cercle électoral se partageait entre quatre principales forces ; puis la percée du Front national d’abord [12], de l’écologisme ensuite, ont durablement modifié cette donne, tandis que s’effondraient le PC et l’UDF – laquelle, après la présidentielle de 2002, est presque intégralement diluée dans un vaste nouveau parti de droite gouvernementale, l’UMP [13] autour de Chirac, vainqueur atypique [14] du deuxième tour contre Jean-Marie Le Pen.
L’abstention-miroir
Depuis plus de trente-cinq ans, entre la victoire de Mitterrand en 1981 et celle de Macron en 2017, perdure en France une crise qui se manifeste de deux manières : un rejet systématique du pouvoir sortant, et des pics d’abstention jamais atteints auparavant.
A la présidentielle de 1981, Giscard est battu par Mitterrand ; aux législatives de 1986, Mitterrand est battu par Chirac et doit céder le gouvernement à la droite ; à la présidentielle de 1988, Chirac doit rendre le pouvoir à Mitterrand ; à la législative de 1992, Mitterrand doit de nouveau céder le gouvernement à la droite et prendre Edouard Balladur comme Premier ministre ; en 1995, Balladur, après deux ans d’exercice du pouvoir, perd la présidentielle contre Chirac ; aux législatives de 1997, Chirac doit céder pour cinq ans le gouvernement à la gauche conduite par Lionel Jospin ; le même Jospin, s’étant porté candidat à la présidentielle de 2002, ne passe même pas au deuxième tour. La présidentielle de 2007 est une exception, qui voit l’élection de Nicolas Sarkozy, ministre du gouvernement sortant – mais on notera qu’il mène alors une campagne résolument à droite, contredisant le principe giscardien disposant qu’une élection se gagne toujours au centre, ce qui lui permet d’élargir son angle sur sa droite et capter un tiers des voix de Jean-Marie Le Pen : à tort ou à raison, il n’était pas regardé comme systématiquement responsable de la politique conduite par Chirac et ses premiers ministres, donc qu’il n’était pas un véritable « sortant ».[…]
[lire la suite dans notre numéro]
Yves-Marie Adeline
Rappelons qu’Yves-Marie Adeline a publié, entre autres, Histoire mondiale des idées politiques (Ellipses, 2007), Abrégé des définitions politiques (Ellipses, 2011), La Droite impossible (Chiré, 2012), Les Nouveaux seigneurs, considérations sur la montée irrésistible d’une nouvelle aristocratie, en version anglaise The new peers, considerations on unstoppable rise of a new aristocraty, translation by author and Mahalia Gayle, Ph D. Harvard university, Amazon publishing, 2017.
[1] – L’expérience montre que dans une élection locale, un candidat nouveau, qui se présente sans l’étiquette d’un parti, peut avoir d’emblée un niveau d’étiage de 0,50 % : tout son travail va donc consister à dépasser ce niveau.
[2] – Union pour la Démocratie Française, un parti original car composé à la fois de partis déjà existants (Parti républicain dont Giscard lui-même est issu, Démocrates-sociaux, Radicaux valoisiens, etc.) et d’adhérents directs.
[3] – En 1976, il présente à Giscard sa démission de Premier ministre et crée son parti, le Rassemblement pour la République.
[4] – Nous utilisons ce terme à droite et à gauche sans péjoration mais en fonction de son étymologie latine radix, la racine : ce qui s’en tient à son principe. Nous avons exposé dans plusieurs ouvrages comme La Droite impossible (voir les références de nos ouvrages à la fin de cette étude) que la droite reconnaît l’existence d’obligations par-delà le libre-choix, tandis que la gauche s’attache au principe de l’émancipation.
[5] – Notons que le système électoral législatif déforme la réalité des suffrages exprimés, car il n’y a alors que 700 000 voix d’écart entre la gauche et la droite. Ainsi les électeurs de droite seront-ils surpris de la victoire de la gauche à la présidentielle de 1981, plus représentative car se déroulant dans une seule circonscription, la France entière.
[6] – Lui et Marie-France Garaud ont été écartés en 1979 après le relatif échec de Chirac aux premières élections européennes.
[7] – In hebdomadaire L’Express du 10 juillet 1981.
[8] – Rappelons que le referendum, à l’issue duquel les électeurs français devaient rejeter ou approuver le Traité de Maastricht, portait sur le renforcement des institutions européennes, notamment par la création d’une monnaie unique.
[9] – Mentionnons l’existence d’une tendance socialiste souverainiste incarnée alors par Jean-Pierre Chevènement.
[10] – A l’annonce de son résultat, il déclare qu’il vient de « former une famille [politique, nda], et que, comme toute famille, celle-ci a vocation à s’agrandir » : il croyait donc que son succès recomposait la droite.
[11] – Certes, l’initiative de cette loi revient à Giscard et son gouvernement conduit par Chirac, mais tous les députés de gauche ont voté pour, tandis que les 189 qui ont voté contre étaient tous de droite.
[12] – Aux européennes de 1984, le FN obtient 11 %, tandis que les Écologistes n’atteignent pas 3,5 %. Mais aux mêmes élections 1989, ils récolteront 10,5 % des voix.
[13] – UMP : Union pour la Majorité Présidentielle, puis Union pour un Mouvement Populaire, devenue Les Républicains en 2015.
[14] – Il obtient 82,21 % des voix, ayant bénéficié du report de celles de la gauche.
Suggestion de livres sur ce thème :